Foot-Land - jeu de foot fun et convivial
Forum officiel du meilleur jeu de foot français
Vous n'êtes pas identifié.
#1 06-10-2008 20:20:54
- daminoux-91
- Bavard(e)
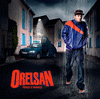
- Serveur 1
- Lieu: IDF SUD
- Date d'inscription: 08-07-2008
La guerre de cent ans.
La guerre de Cent Ans couvre la période de 116 ans (1337 à 1453) pendant laquelle s’affrontent la France et l’Angleterre lors de nombreux conflits, entrecoupés de trêves plus ou moins longues.
La guerre commence lorsque Édouard III d’Angleterre envoie un défi (déclaration de guerre) au roi de France Philippe VI de Valois. Le traité de paix définitif, signé le 29 août 1475 à Picquigny en Picardie, en marque officiellement la fin. Cependant, on retient plutôt l'année 1453, date à laquelle les Anglais sont totalement chassés de France (sauf Calais).
Le conflit a débouché sur la constitution de deux nations européennes indépendantes : la France et l’Angleterre qui, jusqu’alors, étaient imbriquées juridiquement et culturellement, et étaient en lutte pour le contrôle territorial de l’Ouest de la France. Pour le contrôle de ce territoire, les Plantagenêts (dynastie royale anglaise) et les Capétiens avaient déjà lutté près de 140 ans, entre 1159 et 1299[1]. Cette première période avait vu évoluer les deux royaumes d’une organisation féodale très morcelée à une structure d’État centralisé. Le problème posé par le duché de Guyenne n’ayant pas été résolu, (le roi d’Angleterre étant théoriquement vassal du roi de France en tant que duc d’Aquitaine) à la fin du dernier conflit, mais aussi leurs intrigues pour prendre le contrôle de la Bretagne et des Flandres sont à l’origine du déclenchement des hostilités. Cependant, la cause profonde du conflit est la crise démographique puis économique et sociale que traverse le monde médiéval occidental depuis le début du XIVe siècle.
Sommaire
[masquer]
* 1 Forces en présence
o 1.1 Royaume de France
o 1.2 Royaume d'Angleterre
* 2 Origines du conflit
o 2.1 Causes culturelles, démographiques, économiques et sociales du conflit
o 2.2 Sphères d'influences économiques et culturelles de la France et de l'Angleterre
o 2.3 La question dynastique
o 2.4 La querelle de Guyenne
o 2.5 Intrigues et déclaration de guerre
* 3 Principales phases du conflit
o 3.1 Les victoires d’Édouard III : de 1337 à 1364
+ 3.1.1 La guerre par procuration
+ 3.1.2 Les chevauchées
+ 3.1.3 Les Valois contestés
+ 3.1.4 Le traité de Brétigny
o 3.2 La reconquête de Charles V le Sage : de 1364 à 1380
o 3.3 Régents et guerre civile : 1380-1429
+ 3.3.1 Mort de Charles V le Sage et débuts de Charles VI : 1380-1392
+ 3.3.2 Armagnacs et Bourguignons : de 1392 à 1429
o 3.4 Les Anglais boutés hors de France : de 1429 à 1475
+ 3.4.1 Jeanne d’Arc
+ 3.4.2 La fin du conflit
+ 3.4.3 Le traité de Picquigny
* 4 Conséquences
o 4.1 Conséquences démographiques
o 4.2 Évolutions tactiques
o 4.3 Conséquences économiques
o 4.4 Grand Schisme d’Occident
o 4.5 Le clivage franco-anglais
o 4.6 Le contentieux bourguignon
* 5 Principaux événements de la guerre de Cent Ans
* 6 La guerre de Cent Ans dans les arts
o 6.1 Romans
o 6.2 Films et séries télévisées
* 7 Bibliographie
o 7.1 Chroniques de l’époque
o 7.2 Essais contemporains en français
o 7.3 Essais contemporains en anglais
* 8 Liens
o 8.1 Articles connexes
o 8.2 Liens externes
* 9 Notes et références
Forces en présence [modifier]
Royaume de France [modifier]
Le royaume de France, irrigué par de grands bassins fluviaux et bénéficiant d'un climat favorable à une agriculture florissante est, avec ses 17 millions d’habitants[2], la première puissance démographique d’Europe. Sa société agricole est fondée sur un régime féodal et religieux très hiérarchisé. La capacité agricole permet de nourrir la population (il n'y a plus eu de famine depuis le XIIe siècle[3]) qui a besoin de la noblesse pour défendre les terres[4].
Le clergé joue un rôle social majeur dans cette organisation de la société. Les clercs, sachant lire et compter, gèrent les institutions ; les religieux font fonctionner les œuvres caritatives[5] et les écoles[6] ; par le biais des fêtes religieuses, le nombre des jours chômés atteint 140 par an[7].
De la même manière, la noblesse doit conjuguer richesse, pouvoir et bravoure sur le champ de bataille : vivant du labeur des paysans, le maître se doit de manifester sa bravoure et sa loyauté envers eux[4]. L'Église a œuvré pour canaliser les chevaliers-brigands dès la fin du Xe siècle. À partir du concile de Charroux en 989, les hommes en armes sont priés de mettre leur puissance au service des pauvres et de l'Église et deviennent des milites Christi (soldats du Christ)[8]. Depuis le XIIIe siècle, le roi de France avait pu faire admettre l'idée que son pouvoir de droit divin lui permettait de créer des nobles[9]. La noblesse se différencie donc du reste de la population par son sens de l'honneur et doit faire montre d'esprit chevaleresque, protéger le peuple et rendre justice en préservant un certain confort matériel. Elle doit justifier sur le champ de bataille son statut social : l’adversaire doit être vaincu face à face dans un corps à corps héroïque. L’armée est donc structurée autour de la chevalerie la plus puissante d’Europe, cavalerie lourde combattant de front, au corps à corps[10]. Cette volonté de briller sur les champs de bataille est accrue par l’habitude de l’époque de faire des prisonniers et de monnayer leur libération contre rançon. La guerre devient donc très lucrative pour les bons combattants et les risques d’être tués sont donc amoindris pour les autres[11]. Depuis Philippe le Bel, le roi peut convoquer « le ban et l'arrière-ban », c'est-à-dire tous les hommes de 15 à 60 ans, de toute condition (chevaliers et paysans, jeunes et vieux, riches et pauvres). Vers 1340, Philippe VI peut compter sur 30 000 hommes d'armes ainsi que 30 000 hommes de pied. Numériquement, c'est inégalable, car l'entretien d'un tel nombre de combattants représente un coût extraordinairement élevé, mais c'est une armée hétéroclite et peu disciplinée[12].
Pour assoir leur pouvoir face à la grande noblesse et à la papauté, les Capétiens ont donné des gages au peuple : créations de villes franches avec octroi de chartes de franchises, création des états généraux[13]... L'équilibre social passe par l'acceptation par le peuple d'un pouvoir royal fort, qui l’émancipe de l’arbitraire féodal, et une administration de plus en plus centralisée qui lui assure un certain confort matériel.
À la veille de la guerre de Cent Ans, ce système se fragilise car à la suite de la croissance démographique qui a lieu depuis le Xe siècle, on assiste à une surpopulation des campagnes et à une demande d’autonomie des villes[14]. La taille des parcelles des paysans se réduit et les prix agricoles chutent : les ressources fiscales de la noblesse diminuent et il devient impératif de briller sur le champ de bataille pour renflouer ses finances.
En trois siècles, les rois capétiens ont réussi à consolider leur autorité et à agrandir leur territoire, aux dépens des Plantagenêts. Le prestige royal de la France est immense, et, au temps de Philippe IV le Bel, le réseau d’alliances françaises s’étend jusqu’en Russie[10].
Toutefois, malgré les confiscations territoriales de Philippe II Auguste, saint Louis et Philippe IV le Bel, les rois d’Angleterre ont conservé l’étroit duché de Guyenne et le petit comté de Ponthieu : le roi d’Angleterre est ainsi le vassal du roi de France.
Yvain secourant la damoiselle. Enluminure tirée d'une version de Lancelot du Lac du XVe siècle. Le chevalier doit avoir un comportement loyal, le combat est l'occasion de justifier son statut social.
Yvain secourant la damoiselle. Enluminure tirée d'une version de Lancelot du Lac du XVe siècle. Le chevalier doit avoir un comportement loyal, le combat est l'occasion de justifier son statut social.
Icône de détail Article détaillé : Capétiens contre Plantagenêts.
Royaume d'Angleterre [modifier]
La Magna Carta, ou « Grande Charte »
La Magna Carta, ou « Grande Charte »
Le royaume d’Angleterre est beaucoup moins peuplé (quatre millions d’habitants). Le refroidissement climatique qui touche l’Europe à partir du XIIIe siècle oblige le pays à renoncer à certaines ressources agricoles (par exemple : le vin qui était produit dans tout le sud de l’Angleterre n’est progressivement produit qu’en Guyenne[15]) et à opter pour une économie fondée sur la spécialisation et le commerce[16]. Le climat pluvieux et les pâturages verdoyants favorisent l’élevage (plus particulièrement des ovins) qui permet une production importante de la laine utilisée par les tisserands et les drapiers (les ovins anglais produisent une laine particulièrement fine et d’excellente qualité pour le filage[17]). L’artisanat, le commerce et donc les villes se sont développés[18]. Les habitants des villes ont surtout besoin de liberté d’entreprendre et de limiter la pression fiscale (une grande partie des finances de l’État vient de la taxe sur la laine)[19]. De même, les propriétaires fonciers (barons et clergé) voient d'un mauvais œil l'augmentation des impôts rendue nécessaire par le financement de la guerre contre Philippe Auguste, d'autant que Jean sans Terre accumule défaites et pertes territoriales. Ce dernier doit leur concéder la Grande Charte de 1215 qui garantit la liberté des villes et donne au Parlement anglais un pouvoir de contrôle sur la fiscalité[20].
Le commerce rend l’Angleterre très dépendante de la Guyenne (car elle produit des vins qui à l’époque sont plus salubres que l’eau), des Flandres (dont les drapiers achètent la laine) et de la Bretagne (qui lui vend du sel indispensable à la conservation des aliments)[21].
Depuis deux siècles, la souveraineté sur l'ouest de la France, du duché d'Aquitaine au riche et puissant comté de Flandre, est à l'origine de conflits et d'intrigues entre Capétiens et Plantagenêts. Cette lutte commencée au milieu du XIIe siècle avec un énorme avantage pour l’Anglais (qui possédait alors l’Anjou, la Normandie, le Maine, le Poitou, l’Aquitaine et le Limousin), se termine par la confiscation de ses possessions au profit du roi de France[22]. Du grand empire Plantagenêt, il ne reste plus qu’une Aquitaine diminuée et réduite à la côte gasconne et à Bordeaux, nommée Guyenne.
D’autre part, l’Angleterre prend part à la 2e guerre d'indépendance d'Écosse (1332 à 1357). Depuis 1296, profitant de la mort d’Alexandre III sans héritier mâle et une tentative de prise de contrôle par mariage, l’Angleterre considère l’Écosse comme un État vassal. Cependant, les Écossais ont contracté avec la France, la Auld Alliance, le 23 octobre 1295, et Robert Bruce, lors de la bataille de Bannockburn, a écrasé la chevalerie anglaise pourtant très supérieure en nombre grâce à une armée essentiellement composée d’hommes d’armes à pied protégés des charges par un premier rang de piquiers[23]. Les Anglais adaptent donc leur manière de combattre en diminuant la cavalerie mais en utilisant plus d’archers et d’hommes d’armes à pied protégés des charges par des pieux plantés dans le sol (ces unités pour accroitre leur mobilité se déplacent à cheval mais combattent à pied)[24][25]. Édouard III met en œuvre cette nouvelle façon de combattre en soutenant Édouard Balliol contre les partisans de David II, le fils de Robert Bruce. Grâce à cette tactique, les Anglais remportent plusieurs batailles importantes dont la bataille de Dupplin Moor en 1332 et celle de Halidon Hill en 1333[26]. David II doit s’enfuir et trouve refuge en France où il est accueilli par Philippe VI de Valois.[27] Édouard Balliol devient roi d’Écosse, vassal de l’Angleterre et honni par son peuple. Grâce à cette campagne, Édouard III peut disposer d’une armée moderne et rodée aux nouvelles tactiques (il y a aussi expérimenté la stratégie des chevauchées qui consiste à piller le pays sur des distances énormes grâce à une armée montée[24]).
La langue des élites est le franco-normand — soit un français mâtiné de mots nordiques apportés par les Vikings — depuis 1066 (conquête par Guillaume le Conquérant) jusqu’en 1361, décret d’Édouard III)[28], bien que l'anglo-saxon continue d'être employé par le peuple.
Icône de détail Articles détaillés : Magna Carta et Arc long anglais.
Origines du conflit [modifier]
Icône de détail Article détaillé : Capétiens contre Plantagenêts.
Si on trouve les raisons profondes du conflit dans la crise démographique, économique et sociale que traverse l’Europe du XIVe siècle, le déclenchement de la guerre est motivé par la montée progressive de la tension entre les rois de France et d’Angleterre au sujet de la Guyenne, des Flandres et de l'Écosse. La question dynastique, posée par une interruption de la descendance mâle directe des Capétiens en est le prétexte officiel.
Causes culturelles, démographiques, économiques et sociales du conflit [modifier]
Alors que, sous l’effet des progrès des techniques agraires et des défrichements, la population s’accroît en Occident depuis le Xe siècle, on franchit un seuil qui dépasse les capacités de productions agricoles dans certaines zones d’Europe dès la fin du XIIIe siècle. Avec le jeu des partages successoraux les parcelles se réduisent : elles n’ont plus en 1310 que le tiers de leur superficie moyenne de 1240[3]. Certaines régions comme les Flandres sont en surpopulation et essayent de gagner des terres cultivables sur la mer, néanmoins pour couvrir leurs besoins, elles optent pour une économie de commerce permettant d’importer les denrées agricoles. En Angleterre, dès 1279, 46 % des paysans ne disposent que d’une superficie cultivable inférieure à 5 hectares. Or, pour nourrir une famille de 5 personnes, il faut de 4 à 5 hectares[3]. La population rurale s’appauvrit, le prix des produits agricoles baisse et les revenus fiscaux de la noblesse diminuent alors que la pression fiscale augmente et donc les tensions avec la population rurale. Beaucoup de paysans tentent donc leur chance comme saisonniers dans les villes pour des salaires très faibles engendrant aussi des tensions sociales en milieu urbain. Le refroidissement climatique[15] provoque de mauvaises récoltes qui se traduisent du fait de la pression démographique en famines (qui avaient disparu depuis le XIIe siècle) dans le nord de l’Europe en 1314, 1315 et 1316: Ypres perd 10 % de sa population et Bruges 5 % en 1316[3].
La noblesse doit compenser la diminution de ses revenus fonciers et la guerre en est un excellent moyen : par les rançons perçues après capture d’un adversaire, le pillage et l’augmentation des impôts justifiée par la guerre. C’est ainsi que la noblesse pousse à la guerre et particulièrement la noblesse anglaise dont les revenus fonciers sont les plus touchés[11]. En France, le roi Philippe VI a besoin de renflouer les caisses de l'état et une guerre permettrait de lever des impôts exceptionnels.
Sphères d'influences économiques et culturelles de la France et de l'Angleterre [modifier]
Sphères d'influence et principaux axes commerciaux au royaume de France en 1330. ██ Possessions de Jeanne de Navarre ██ États pontificaux ██ Territoires contrôlés par Édouard III ██ Zone d'influence économique anglaise ██ Zone d'influence culturelle française
Sphères d'influence et principaux axes commerciaux au royaume de France en 1330. ██ Possessions de Jeanne de Navarre ██ États pontificaux ██ Territoires contrôlés par Édouard III ██ Zone d'influence économique anglaise ██ Zone d'influence culturelle française
Depuis saint Louis, la modernisation du système juridique attire dans la sphère culturelle française de nombreuses régions limitrophes: en particulier en terres d'Empire, les villes du Dauphiné ou du comté de Bourgogne (future Franche-Comté) recourent depuis saint Louis à la justice royale pour régler des litiges: le roi envoie, par exemple, le bailli de Mâcon qui intervient à Lyon pour régler des différends, comme le sénéchal de Beaucaire intervient à Vivier ou à Valence[29]. Les rois de France savent attirer à leur cour la noblesse de ces régions en allouant des rentes et en se livrant à une habile politique matrimoniale. Les comtes de Savoie prêtant hommage au roi de France contre l'octroi de pensions ; Jean de Luxembourg, roi de Bohème et beau-père de Jean le Bon mourant héroïquement à Crécy ou le comte Humbert II ruiné du fait de son incapacité à lever l'impôt[30] et sans héritier après la mort de son fils unique, vendant le Dauphiné[31] à Philippe VI sont de parfaites illustrations de ce phénomène. Inversement, le fait que le roi d'Angleterre soit vassal du roi de France pour la Guyenne lui pose problème car tous les litiges peuvent être réglés à Paris et donc en sa défaveur.
L’essor du commerce a rendu certaines régions dépendantes économiquement de l’un ou de l’autre royaume. À cette époque, le transport de fret se fait essentiellement par voie maritime ou fluviale. La Champagne et la Bourgogne alimentent Paris via la Seine et ses affluents et sont donc pro-françaises. La Normandie est partagée car elle est le point d'union entre ce bassin économique et la Manche qui devient une zone d'échanges de plus en plus intenses grâce aux progrès des techniques maritimes (le contournement de la péninsule ibérique par les navires italiens devient de plus en plus fréquent). L’Aquitaine qui exporte son vin en Angleterre, la Bretagne qui exporte son sel et les Flandres qui importent la laine britannique ont tout intérêt à être dans la sphère d'influence anglaise[21].
Ainsi les Flamands en voulant échapper à la pression fiscale française, se révoltent de manière récurrente contre le roi de France ; d'où les batailles successives de Courtrai en 1302 (où la chevalerie française est laminée) de Mons-en-Pévèle en 1304 et de Cassel en 1328 (où Philippe VI mate les rebelles flamands). Les Flamands apportent leur soutien au roi d'Angleterre, déclarant même en 1340 qu'Édouard III est le légitime roi de France. Les deux États ont donc intérêt à augmenter leurs possessions territoriales pour accroître leurs rentrées fiscales et renflouer leurs finances. Dès lors, les intrigues des deux rois pour faire passer la Guyenne, la Bretagne et les Flandres sous leur influence conduisent rapidement à la guerre entre les deux États[32]: elle durera 116 ans.
La question dynastique [modifier]
Descendance de Philippe III le Hardi, roi de France (1270-1285)
Descendance de Philippe III le Hardi, roi de France (1270-1285)
Pour comprendre la question dynastique de 1328, il faut remonter une dizaine d’années dans le temps :
En 1316, la mort de Louis X le Hutin, deux ans seulement après celle de son père Philippe le Bel, marque la fin du miracle capétien : de 987 à 1316, les rois capétiens ont toujours eu un fils à qui transmettre la couronne à leur mort. De sa première épouse, Marguerite de Bourgogne qui fut condamnée pour infidélité[33], Louis X le Hutin n’a qu’une fille, Jeanne de Navarre. À sa mort, sa seconde femme attend un enfant. Un fils naît : Jean Ier dit le Posthume, mais il ne vit que quelques jours. Cas inédit jusqu’alors, l’héritier direct du royaume de France se trouve donc être Jeanne de Navarre, une femme. La décision qui est prise à ce moment est très importante, car elle est devenue coutume et fut appliquée sur la question dynastique qui se posa en 1328. L’infidélité de la reine Marguerite n'est qu'un prétexte pour l’éviction de sa fille Jeanne, et du choix de Philippe V (frère de Louis X le Hutin) comme roi de France. En fait, il s’agit d’un choix géopolitique, le refus de voir un éventuel étranger épouser la reine et diriger le pays. Le choix du monarque français se fonde sur l'hérédité et le sacre, mais l’élection reprend ses droits en cas de problème. Le principe de la loi salique découle de la volonté des Capétiens de renforcer leur possessions en rattachant à la couronne les fiefs de leurs vassaux sans héritiers mâles: Philippe le Bel avait introduit la « clause de la masculinité », selon l’expression de Jean Favier, en révisant, la veille de sa mort, le statut de l’apanage de Poitou qui, « faute d’héritier mâle, reviendrait à la couronne de France »[22]. La loi salique n’est pas invoquée lors du choix du nouveau roi de France. Ce n’est que trente ans plus tard, vers 1350, qu’un bénédictin de l’abbaye de Saint-Denis, qui tient la chronique officielle du royaume, invoque cette loi pour renforcer la position du roi de France dans le duel de propagande qu’il livre à Édouard III d’Angleterre[34]. Cette loi date des Francs et stipule que les femmes doivent être exclues de la « terre salique ». Le terme salique provient de la rivière Sala, aujourd'hui Yssel, en Belgique, terre des Francs saliens[35]. Cette loi est reprise, adaptée à la situation et avancée comme argument de poids dans les disputes sur la légitimité du roi.
Après le court règne de Philippe V, mort sans héritier mâle, c’est son plus jeune frère, Charles IV, qui, bénéficiant du précédent posé par son aîné, ceint à son tour la couronne. Mais son règne dure également peu de temps.
Quand ce troisième et dernier fils de Philippe le Bel meurt sans descendant mâle en 1328, la question dynastique est la suivante : Isabelle de France, dernière fille de Philippe le Bel, a un fils, Édouard III, roi d’Angleterre. Peut-elle transmettre un droit qu’elle ne peut elle-même exercer selon la coutume fixée dix ans plus tôt ? Édouard III se propose comme candidat, mais c’est Philippe VI de Valois qui est choisi[22]. Il est le fils de Charles de Valois , frère cadet de Philippe le Bel et descend donc par les mâles de la lignée capétienne. Les pairs de France refusent de donner la couronne à un roi étranger, suivant la même logique de politique nationale que dix ans auparavant[36]. Avec bien certaines réticences, Édouard III d’Angleterre prête alors hommage à Philippe VI, étant son vassal au titre de la Guyenne[37]
Icône de détail Article détaillé : Succession de Charles IV le Bel.
Édouard III, ayant prêté hommage et reconnu pour roi Philippe VI de Valois, et ayant dû accepter des concessions en Guyenne (mais il se réserve le droit de réclamer les territoires arbitrairement confisqués)[22], il s'attend à ce qu'on lui laisse les mains libres en Écosse. Mais Philippe VI confirme son soutien à David Bruce, Édouard III saisit alors le prétexte de sa légitimité royale pour déclencher la guerre[38].
France en 1330██ Territoires anglais en 1330██ Royaume de France ██ Possessions des Plantagenêts en 1180
France en 1330██ Territoires anglais en 1330██ Royaume de France ██ Possessions des Plantagenêts en 1180
La querelle de Guyenne [modifier]
Cette querelle est encore plus importante que la question dynastique pour expliquer le déclenchement de la guerre[38]. La Guyenne pose un problème considérable aux rois de France et d’Angleterre : Édouard III se trouve être le vassal de Philippe VI de France et doit donc reconnaitre la souveraineté du roi de France sur la Guyenne. Dans la pratique, un jugement rendu en Guyenne peut être soumis à un appel devant la cour de Paris et non pas à Londres. Le roi de France a donc le pouvoir de révoquer toutes les décisions juridiques prises par le roi d'Angleterre en Aquitaine, ce qui est bien sûr totalement inacceptable pour les Anglais. Dès lors, la souveraineté sur la Guyenne fait l'objet d'un conflit larvé entre les deux monarchies depuis plusieurs générations.
En 1323, le père de Philippe VI, Charles de Valois, en expédition pour le compte du roi Charles IV le Bel, fait saisir une bastide fortifiée construite par les Anglais à Saint-Sardos, en plein territoire du duc de Guyenne, malgré les plus vives protestations et recours en justice d'Édouard II d'Angleterre et du seigneur voisin Raymond-Bernard de Montpezat. Ce dernier répliqua par les armes le 16 octobre 1323, alors que le procureur du roi de France se trouvait à Saint-Sardos pour officialiser l'alliance. À la tête de sa troupe, renforcée d'éléments anglais, le seigneur de Montpezat attaqua le château de Saint-Sardos et ruina le village. Il fit passer la garnison au fil de l'épée et le représentant de Charles IV fut pendu. Devant ce prétexte tout trouvé, le Parlement, arguant que le duc de Guyenne n’avait pas prêté hommage à son suzerain, confisque le duché en juillet 1324. Le roi de France envahit la quasi-totalité de l'Aquitaine mais accepta de mauvaise grâce de restituer ce territoire en 1325. Pour recouvrer son duché, le roi Édouard II d’Angleterre doit transiger : il envoie son fils, le futur Édouard III, prêter l’hommage mais le roi de France ne lui propose qu’une Guyenne amputée de l’Agenais. Les choses semblent se débloquer en 1327 à l’avènement d’Édouard III qui recouvre son duché contre la promesse d’une indemnité de guerre. Mais les Français, faisant traîner en longueur la remise des terres, forcent Édouard III à venir prêter hommage, ce qu’il fait le 6 juin 1329. Mais, lors de cette cérémonie, Philippe VI fait consigner que l’hommage n’est pas prêté pour les terres qui ont été détachées du duché de Guyenne par Charles IV le Bel (en particulier l’Agenais). Édouard considère que son hommage n’implique pas la renonciation de la revendication des terres extorquées[39].
Intrigues et déclaration de guerre [modifier]
La tension monte entre les deux souverains d'autant que la noblesse pousse au conflit, elle débouche inévitablement sur une déclaration de guerre en 1337.
Le roi de France aide les Écossais dans leur combat contre l’Angleterre. C’est la politique menée depuis plusieurs siècles par les rois capétiens : il s’agit de la Vieille Alliance. Le roi d’Écosse, David Bruce, a été chassé par Édouard III en 1333 et Philippe VI l’héberge à Château-Gaillard et réarme ses partisans en attendant qu’il ait reconstitué des forces suffisantes pour reprendre pied en Écosse.
En 1334, il convoque les ambassadeurs anglais, dont l’archevêque de Canterbury et leur précise que l’Écosse de David Bruce est comprise dans la paix[40][41]. En 1335, David Bruce peut attaquer les îles Anglo-Normandes grâce à une flotte financée par Philippe VI. C'est un échec, mais cela fait craindre à Édouard III une invasion de l'Angleterre[42].
Édouard III intrigue en Flandres, son mariage avec Philippa de Hainaut lui permet de tisser des liens dans le nord de la France et dans le Saint-Empire : Robert d'Artois est réfugié à Londres depuis 1336[43], il a acheté l'alliance du comte de Hainaut ainsi que celle de l'empereur Louis de Bavière pour 300 000 florins et le duc de Brabant ainsi que le comte Gueldre se tournent vers lui[44]. Les Flamands sont outrés par le ralliement du comte Louis Ier de Flandre au roi de France et de la pression fiscale qui s'ensuit, mais en cas de relance du conflit avec le roi de France, ils devraient verser une lourde amende au pape (qui a le pouvoir de les excommunier ou de jeter l'interdit sur les villes flamandes). Il est prévu avec Jacob Van Artevelde (l'homme fort de l'opposition flamande) que les Flandres reconnaissent Édouard comme roi de France ce qui permet de contourner cet accord[32]. Louis de Nevers réagit en arrêtant des marchands anglais. Édouard III coupe l’approvisionnement en laine de cette région en août 1336[44], menaçant son économie[32] constituée essentiellement de draperie et de tissage. Mais surtout il soutient l'industrie textile du Brabant auquel il est allié et prend des mesures incitatives pour faire venir en Angleterre les tisserands flamands désœuvrés pour y créer sa propre industrie textile. Si la Flandre reste neutre ou prend le parti du roi de France elle perdra tout son pouvoir économique et elle est menacée de ruine[45]. La Flandre se révolte contre les Français en 1337.
Par mesure de rétorsion, Philippe VI décide donc de confisquer la Guyenne pour félonie. Édouard III d’Angleterre réplique en revendiquant la couronne de France. Le 7 octobre 1337, un archevêque est envoyé à Paris pour jeter le gant à « Philippe, qui se dit roi de France »[22]. La guerre commence.
Principales phases du conflit [modifier]
La guerre de Cent Ans comprend deux grands mouvements qui répondent à une même structure : une première période, de 1337 à 1380, qui voit l’effondrement de la puissance de la monarchie française, puis une période de crise suivie d’un rétablissement et d’une seconde période, de 1415 à 1453, reproduisant le même cycle : effondrement, crise, rétablissement. Ces deux périodes sont séparées par une longue trêve provoquée par des conflits de pouvoir dans les deux camps.
On peut subdiviser chacune de ces deux grandes périodes en deux phases :
██ Territoires contrôlés par les Français ██ Territoires contrôlés par les Anglais ██ Territoires contrôlés par le duc de Bourgogne
██ Territoires contrôlés par les Français ██ Territoires contrôlés par les Anglais ██ Territoires contrôlés par le duc de Bourgogne
* De 1337 à 1364, le génie tactique d’Édouard III d’Angleterre entraîne une succession de victoires anglaises sur la chevalerie française. La noblesse française est complètement discréditée et le pays sombre dans la guerre civile. À la suite du traité de Brétigny, une grande partie de la France est contrôlée par les Anglais.
* De 1364 à 1380, Charles V entame une patiente reconquête du territoire. Le roi a compris que la victoire finale se jouerait sur le sentiment d’appartenance nationale. Il laisse les Anglais ravager la campagne par des chevauchées alors que lui-même soulage la population en envoyant les Grandes compagnies combattre en Castille. Évitant les batailles rangées qui ont été désastreuses durant la première phase du conflit, il reprend progressivement plusieurs places fortes à l’ennemi. En 1375, Édouard III ne contrôle plus sur le continent que Calais, Cherbourg, Brest, Bordeaux, Bayonne, et quelques forteresses dans le Massif central.
* De 1380 à 1429, la minorité puis la folie de Charles VI permettent aux « grands », les membres de la haute noblesse française, de prendre le contrôle du royaume. Il en résulte une rivalité entre les ducs de Bourgogne et d’Orléans qui dégénère en guerre civile. Henri V en joue et reprend du terrain sur le continent. Il en résulte le désastre français de la bataille d’Azincourt. En 1419, l’assassinat de Jean sans Peur entraîne une alliance anglo-bourguignonne et l’effondrement du parti d’armagnac. En vertu du traité de Troyes de 1420, Henri V épouse la fille de Charles VI, devient l’héritier de ce dernier et cumule les titres de roi d’Angleterre et de régent de France. Le Dauphin Charles est déshérité. Cependant, à la suite de la mort prématurée d’Henri V, son fils Henri VI, âgé de quelques mois, prend le titre de roi de France et d’Angleterre.
* De 1429 à 1453, les Anglais sont progressivement chassés de France. Jeanne d’Arc cristallise le sentiment national et assoit Charles VII sur le trône en dépit du traité de Troyes qui l’avait déshérité. Les Anglais privés du soutien de la population sont lentement chassés du continent. En 1435, le traité d’Arras met fin à l’alliance anglo-bourguignonne et déséquilibre définitivement le rapport de force en faveur des Français. En 1453, les Anglais ne contrôlent plus que Calais suite à leur défaite subie à Castillon. Mais la paix n’est finalement signée qu’en 1475, sous les règnes de Louis XI et d’Édouard IV.
Les victoires d’Édouard III : de 1337 à 1364 [modifier]
Édouard III
Édouard III
La guerre par procuration [modifier]
Si la guerre est déclarée en 1337, le conflit ne débute que plus tard. Les deux rois ne sont pas riches, et doivent négocier les impôts avec leur parlement respectif, voire emprunter l’argent nécessaire à la guerre.
Les belligérants commencent la guerre par alliés interposés. Ainsi, Édouard III d’Angleterre soutient Jean de Montfort contre Charles de Blois, parent de Philippe VI, lors de la guerre de succession de Bretagne[46]. De leur côté, les Français soutiennent les Écossais en guerre contre les Anglais[47].
Au début du conflit, tandis qu’Édouard III, en tant que petit-fils de Philippe le Bel, peut revendiquer la couronne de France, le roi de France, n’ayant pas de revendication sur la couronne d’Angleterre, n’a qu’un but : récupérer la Guyenne. Il lui faut donc contraindre Édouard III d’Angleterre à en accepter la confiscation et à mettre fin à ses prétentions à la couronne de France.
Bataille de l’Ecluse à Sluys - Miniature tirée des Chroniques de Jean Froissart.
Bataille de l’Ecluse à Sluys - Miniature tirée des Chroniques de Jean Froissart.
Les Français, avec le renfort de mercenaires génois, ont le rapport de force maritime pour eux. Ainsi, la flotte française pille régulièrement les ports anglais[48]. Une stratégie de blocus est imaginée car le vin de Guyenne et le sel de Bretagne ou de Poitou sont vitaux pour l’Angleterre[49]. Le commerce de la laine vers les Flandres et du vin de Bordeaux est interrompu et les finances anglaises sont au plus mal. Les drapiers flamands sévèrement touchés par le conflit se soulèvent contre leur comte Louis Ier de Flandre[50]. Ils sont conduits par Jacob Van Artevelde qui a pris le pouvoir en Flandres et s’allient au roi d’Angleterre.[51].
Le commerce ayant repris avec l’Angleterre, les Français envoient leur flotte à Sluys, à l’embouchure du canal reliant Bruges à la Mer du Nord, pour imposer un blocus naval. Le 24 juin 1340, lors de la bataille de l’Écluse, la flotte française subit une sévère défaite qui inverse le rapport de force maritime. Cette défaite met fin au projet d’envoyer des troupes françaises soutenir les Écossais, et permet à Édouard III d’Angleterre de relancer le commerce de la laine[52]. Au début des années 1340, le retour des laines anglaises ne ramène cependant pas la prospérité en Flandres et l’autorité de Jacob Van Artevelde est de plus en plus contestée. De plus, le pape Clément VI ayant lancé une excommunication aux Flamands parjures[32], Louis de Flandre parvient à reprendre pied dans le comté et force Jacob Van Artevelde à répondre par une fuite en avant. Ce dernier désavoue le comte de Flandre et propose le comté à Edouard de Woodstock, fils d’Édouard III d’Angleterre, le futur Prince Noir. Mais il est trop tard pour lui. Contesté dans sa ville même de Gand, Jacob Van Artevelde est assassiné lors d’une émeute le 17 ou le 24 juillet 1345. La Flandre abandonne dès lors Édouard III et se rallie à la France[53].
1ère phase de la guerre de cent ans ██ Principales batailles de la 1ère phase de la guerre Chevauchée d'Édouard III en 1339 Itinéraire de l'armée d'Édouard III en 1346 Chevauchée du Prince noir en Languedoc en 1355 Chevauchée de Lancastre en 1356 Itinéraire du Prince noir en 1356 Chevauchée d'Édouard III en 1359-60
1ère phase de la guerre de cent ans ██ Principales batailles de la 1ère phase de la guerre
Chevauchée d'Édouard III en 1339
Itinéraire de l'armée d'Édouard III en 1346
Chevauchée du Prince noir en Languedoc en 1355
Chevauchée de Lancastre en 1356
Itinéraire du Prince noir en 1356
Chevauchée d'Édouard III en 1359-60
Fort de sa nouvelle maîtrise maritime, une armée d’Édouard III d’Angleterre débarque à Brest en 1343. Toutefois, son allié Jean de Montfort est capturé à Nantes puis meurt en 1345. Charles de Blois reste seul prétendant au duché de Bretagne. Une trêve est signée en Bretagne, les Anglais gardent le contrôle de Brest jusqu’en 1397.
Redoutant une invasion anglaise, Philippe VI parvient à convaincre son vieil allié écossais d’attaquer l’Angleterre par le nord car, Édouard III ayant regroupé son armée au sud du pays, la frontière écossaise devrait être peu défendue[54]. Le 7 octobre 1346, David II, roi d’Écosse attaque l’Angleterre à la tête de 12 000 hommes. Mais il est défait et capturé à la bataille de Neville’s Cross. Édouard III d’Angleterre a les mains libres pour débarquer en France.
Les chevauchées [modifier]
À cette époque, la France est, avec 20 millions d’habitants, cinq fois plus peuplée que l’Angleterre. La chevalerie française est la plus nombreuse et la plus aguerrie d’Europe. C’est pourquoi Édouard III n’envisage pas de tenir le terrain. Il prévoit une guerre de pillage qui a le mérite de s’autofinancer. La première des célèbres chevauchées anglaises date de 1346 : une armée réduite, mobile, avançant sur un front réduit et pratiquant une guerre totale dévastant systématiquement les régions traversées. Étrange manière de la part d’Édouard III pour prendre possession du royaume qu’il revendique et dont la population, du point de vue juridique anglais, est perçue comme soutenant un usurpateur, Philippe VI de Valois.
Les deux armées se rencontrent à Crécy le 26 août 1346. Les Français sont plus nombreux, mais l’armée française, comptant sur sa chevalerie puissante, affronte une armée anglaise composée d’archers et de fantassins en cours de professionnalisation. Les tactiques utilisées découlent de l’organisation sociale différente des deux pays. La France est un pays féodal et religieux dont la noblesse doit justifier sur le champ de bataille l’origine divine de son pouvoir : on doit vaincre l’adversaire face à face dans un corps à corps héroïque. La noblesse française applique à la lettre les codes de la chevalerie, et combat courtoisement : c’est-à-dire en évitant de tuer un chevalier ennemi de sang noble, mais plutôt en cherchant à le capturer afin de le rançonner.
Bataille de Crécy
Bataille de Crécy
De son côté, l’Angleterre est un pays tourné vers l’artisanat et le commerce. La tactique guerrière des Anglais, rodée par des années de guerre en Écosse, est fondée sur une recherche maximum d’efficacité. Il en résulte une armée très organisée où les chevaliers comptent moins.
Au vu de leur grande supériorité numérique, les Français sont certains de l’emporter à Crécy. Or, confrontée à la baisse de ses revenus fonciers, la noblesse compte se renflouer avec les rançons demandées en échange des chevaliers adverses capturés.[11]. Dès lors, chacun veut atteindre le plus vite possible l’ennemi anglais afin de se tailler la part du lion ; personne n’obéit aux ordres du roi Philippe VI qui, emporté par le mouvement, est contraint de se lancer à corps perdu dans la bataille. Gênés dans leur progression par leurs propres piétons et les arbalétriers mercenaires génois mis en déroute par la pluie de flèches anglaises, les chevaliers français sont obligés d’en découdre avec leurs propres hommes. C’est un désastre du côté français où Philippe VI de Valois s’illustre par son incompétence militaire : les chevaliers français chargent par vagues successives le mont de Crécy, mais leurs montures (à l’époque non ou peu protégées) sont massacrées par les pluies de flèches décochées par les archers anglais abrités derrière des rangées de pieux. Peinant à se relever de leur chute, les chevaliers français, lourdement engoncés dans leurs armures, sont des proies faciles pour les fantassins qui n’ont plus qu’à les achever[55].
L’armée française anéantie, Édouard III remonte vers le nord et met le siège devant Calais. Avec une armée de secours, le roi de France essaie bien de lever le blocus de la ville, mais n’ose pas affronter Édouard III.
Statue des bourgeois de Calais par Rodin
Statue des bourgeois de Calais par Rodin
C’est dans de dramatiques circonstances, au cours desquelles les célèbres bourgeois de Calais remettent les clés de leur ville aux assiégeants, que Calais passe sous domination anglaise, laquelle va durer jusqu’au XVIe siècle. Philippe VI négocie une trêve avec Édouard III, qui, en position de force, obtient la souveraineté pleine et entière sur Calais.
Si la peste noire, ou Grande Peste, de 1349 oblige les belligérants à cesser le combat jusqu’en 1355, elle est aussi vécue comme une punition divine[56]. Philippe VI doit sa couronne à un vote des pairs de France qui ont écarté Édouard III et Philippe d’Evreux. Vaincu par une armée nettement inférieure en nombre à Crécy, le roi de France a dû fuir ce qui met en doute la légitimité divine de son pouvoir[57]. Le prestige et l’autorité royale des Valois sont donc profondément altérés[56]. Le désordre s’installe dans le royaume sans que son successeur, Jean II le Bon, parvienne à inverser la tendance. L’économie va mal et, pour éviter de recourir aux impôts de plus en plus impopulaires, l'état recoure à des mutations qui dévaluent brutalement la monnaie[58]; le commerce se réduit comme une peau de chagrin[59] ce qui conduit les commerçants et artisans à souhaiter plus d’autonomie pour les villes et une monnaie stable. Les mercenaires démobilisés se regroupent en bandes et forment les Grandes compagnies qui terrorisent et pillent les campagnes. L’insécurité grandit sur les routes et dans les campagnes : la noblesse ne remplit plus le rôle qui lui est imparti dans la société féodale.
Icône de détail Article détaillé : Grandes compagnies.
Jean II le Bon
Jean II le Bon
Le roi de Navarre Charles le Mauvais est le petit-fils de Louis X le Hutin. Sa mère Jeanne a renoncé à la couronne de France en 1328, mais il se considère comme l’héritier légitime du trône et passe sa vie à comploter pour le récupérer. Il conclut une alliance avec le Prince Noir[60] et fait assassiner le favori du roi Charles de La Cerda. Jean le Bon, qui ne souhaite pas rompre la trêve avec les Anglais, est obligé d’accepter le traité de Mantes (le 22 février 1354)[61]. Par ce dernier, le Navarrais agrandit son domaine normand de plusieurs vicomtés et fiefs : Beaumont-le-Roger, Breteuil, Conches, Pont-Audemer, Orbec, Valognes, Coutances et Carentan. En contrepartie, il abandonne ses prétentions sur la Champagne.
Assuré du bien-fondé de cette stratégie, et obsédé par le titre de roi de France, il n’hésite pas à conclure un pacte avec Jean de Gand, le troisième fils d'Édouard III[62] au terme duquel la France (dont il obtiendrait la couronne) serait tout simplement partagée[63]. Mais c’est en vain qu’il attend le débarquement promis par Édouard III.
Confronté à la menace anglaise, Jean le Bon doit convoquer les états généraux, le 28 décembre 1355, pour lever l’armée de 30 000 hommes nécessaires. Ceux-ci sont extrêmement méfiants quant à la gestion des finances publiques (échaudés par les dévaluations entraînées par les mutations monétaires[64]) et n’acceptent la levée d’une taxe sur le sel (la gabelle) que si les états généraux peuvent en contrôler l’application et l’utilisation des fonds prélevés. Les officiers qui prélèveraient la taxe doivent être désignés par les états généraux et 10 députés doivent entrer au conseil du roi afin de contrôler les finances[65].
Arrestation de Charles le Mauvais
Arrestation de Charles le Mauvais
La Normandie, région rebelle, refuse de payer: le Dauphin Charles, récemment nommé Duc réunit les états de Normandie. Charles le Mauvais voit dans cette levée impopulaire d'impôt, l'occasion de déstabiliser une couronne chancelante en fédérant les mécontents. Présent au titre de ses possessions normandes (il est comte d’Évreux) , il tente alors un rapprochement avec son beau-frère qu'il essaie de convaincre que son père Jean le Bon souhaite le déshériter (Charles est chétif, selon certaines sources présenterait une malformation de la main droite, est peu avantagé sur les champs de bataille et est donc loin de représenter l'idéal chevaleresque cher à son père)[66]. De ce fait, le 5 avril 1356, le dauphin a convié en son château de Rouen tous les hauts seigneurs de la province. La fête bat son plein lorsque surgit Jean II le Bon qui vient se saisir de Charles le Mauvais. Averti du complot de son beau-fils (il vient de lui donner en mariage sa fille Jeanne de France) avec les Anglais, le roi laisse éclater sa colère qui couve depuis près de deux ans, en fait depuis l’assassinat, en janvier 1354, de son favori le connétable Charles de La Cerda. Il fait décapiter sur-le-champ les compagnons de Charles le Mauvais et fait incarcérer ce dernier[67].
Pendant son incarcération, Charles de Navarre gagne en popularité. Ses partisans le plaignent et réclament sa libération. La Normandie gronde et nombreux sont les barons qui renient l’hommage prêté au roi de France et se tournent vers Édouard III d’Angleterre. Pour eux, Jean le Bon a outrepassé ses droits en arrêtant un prince avec qui il a pourtant signé la paix. Pire encore, ce geste est perçu par les « Navarrais » comme le fait d’un roi qui se sait illégitime et espère éliminer un adversaire dont le seul tort est de défendre ses droits à la Couronne de France. Philippe de Navarre le frère de Charles le Mauvais envoie son défi au Roi de France, le 28 mai 1356[68]. Les Navarrais et particulièrement les seigneurs normands passent en bloc du côté d'Edouard III qui, dès le mois de juin, lance ses troupes dans de redoutables chevauchées, en Normandie et en Guyenne[69]
Bataille de Poitiers
Bataille de Poitiers
Après avoir su mater d'une main de fer, une rébellion dans son comté anglais de Chester, Edouard de Woodstock, fils aîné d'Edouard III, se voit gratifié de la confiance de son père qui lui confie le poste de "lieutenant de Gascogne": ainsi commence la première chevauchée du fameux capitaine anglais. En 1355, le Prince Noir, parti de Bordeaux, pille la campagne française à travers les comtés de Julliac, d'Armagnac et d'Astarac. Ses troupes commettent de nombreuses atrocités dans la région de Carcassonne. L'été de l'année suivante, le Prince Noir revient sur le sol français pour une nouvelle campagne de pillages. Il échoue devant Bourges, mais prend Vierzon dont la garnison est massacrée. Gênée par le poids du butin, sa troupe oblique alors vers l'ouest, puis vers Bordeaux en passant par Poitiers. Jean II le Bon le poursuit avec une armée deux fois plus nombreuse, composée de chevaliers lourds, et le rattrape dans les environs de Poitiers. La bataille de Poitiers a lieu le 19 septembre 1356. Jean II est pris de vitesse par son avant-garde qui attaque sans aucune coordination. Le reste de l'armée française, devant la confusion de la bataille, perd confiance et tourne casaque, et le roi est fait prisonnier avec un de ses fils cadets Philippe : c’est un nouveau désastre[70]. Édouard III a toutes les cartes en main pour négocier d’importantes concessions territoriales et financières. En janvier 1358, Charles de Navarre libéré est en mesure de prendre le pouvoir (il est considéré par beaucoup comme plus apte à combattre l'ennemi anglais et plus légitime que le chétif dauphin[71]). Jean le Bon doit reprendre les choses en main et négocie sa libération: il accepte le premier traité de Londres qui prévoit que l’Angleterre récupère l’ensemble de ses anciennes possessions d’Aquitaine et une rançon de 4 millions d’écus sans renonciation à la couronne de France[72]. À cette occasion, est frappée la première monnaie appelée « franc », ce mot prenant ici le sens de « libre ». Le butin et les rançons acquises à la suite de cette bataille furent tellement importants que de nombreux châteaux anglais furent rénovés ou reconstruits avec ces fonds.[73]
Les Valois contestés [modifier]
Robert Le Coq, dans une diatribe contre les officiers du roi. Grandes Chroniques de France.
Robert Le Coq, dans une diatribe contre les officiers du roi. Grandes Chroniques de France.
Après la bataille de Poitiers, les mercenaires démobilisés se regroupent en grandes compagnies et pillent le pays ce qui accroît le mécontentement populaire. Les défaites de Crécy et Poitiers ont jeté le discrédit sur la noblesse qui est censée prouver l’ascendance divine de son pouvoir sur le champ de bataille[74]. Le roi étant prisonnier, son fils aîné, le Dauphin Charles, réunit les états généraux à partir du 15 octobre 1356. Étienne Marcel, le prévôt des marchands de Paris, y voit la possibilité de mettre en place un régime parlementaire. Allié au parti Navarrais regroupé autour de l’évêque de Laon Robert Le Coq, il impose le 7 novembre la création d’un comité de 80 membres au sein des états généraux[75] (pour faciliter les discussions) qui appuie leurs revendications. Les états généraux, déclarent le dauphin lieutenant du roi et défenseur du royaume en l’absence de son père et lui adjoignent un conseil de douze représentants de chaque ordre[76]. Le Dauphin est proche du courant réformateur et n'est pas contre les réformes proposées. Mais, bien vite, de profonds désaccords surviennent entre le conseil et le dauphin qui refuse de faire juger les anciens conseillers de son père honnis pour avoir brutalement dévalué la monnaie à plusieurs reprises pour renflouer les caisses de l’État[58] ainsi que de faire libérer Charles le Mauvais qui est fortement soutenu (il pourrait y avoir un changement dynastique). Voyant qu’il ne peut contenir les revendications d’Étienne Marcel et de Robert le Coq qui veulent faire libérer Charles de Navarre, le dauphin essaye de gagner du temps et réserve sa réponse (prétextant l'arrivée de messagers de son père[75]), puis congédie les états généraux et quitte Paris, son frère le duc d’Anjou réglant les affaires courantes. Le 10 décembre, le dauphin publie une ordonnance donnant cours à une nouvelle monnaie. Cela provoque une levée de boucliers dans la population qui y voit le risque d’une nouvelle dévaluation et donc d’une forte inflation. Des échauffourées éclatent et Étienne Marcel fait pression sur le duc d’Anjou puis sur le dauphin qui doit révoquer l’ordonnance et rappeler les états généraux[77]. Ceux-ci sont rappelés pour février 1357 et le dauphin accepte une grande ordonnance, qui est promulguée le 3 mars suivant et prévoit le contrôle des finances par les états généraux, l’épuration de l’administration (et particulièrement des collecteurs d’impôts), et enfin le remplacement du conseil du roi par un conseil de tutelle au dauphin, où seraient présents douze députés de chaque ordre des états généraux, mais où il n'est plus question de la libération de Charles de Navarre qui ferait peser un danger réel pour la couronne des Valois.
Charles V ne peut qu'accepter la réconciliation avec Charles de Navarre libéré.
Charles V ne peut qu'accepter la réconciliation avec Charles de Navarre libéré.
Le 9 novembre 1357, le « Navarrais » est libéré de prison par Jean de Picquigny, à l'instigation d’Étienne Marcel et de Jean Lecoq[78].Le retour de Charles de Navarre est méticuleusement organisé : il est libéré le 9 novembre, il est reçu avec le protocole dû au roi dans les villes qu’il traverse, accueilli par les notables et la foule réunie par les états. Le même cérémonial se reproduit à chaque ville depuis Amiens jusqu’à Paris : Il entre avec une magnifique escorte, est reçu par le clergé et les bourgeois en procession, puis il harangue la foule toute acquise, expliquant qu’il a été injustement spolié et incarcéré par Jean le bon alors qu’il est de droite lignée royale. Mis devant le fait accompli, le dauphin ne peut refuser la demande d’Étienne Marcel et de Robert le Coq et signe des lettres de rémissions pour le Navarrais qui effectue tranquillement son triomphal retour. Il rentre à Paris le 29 novembre et harangue 10 000 personnes rassemblées par Étienne Marcel (ce qui est considérable pour l’époque)[79]. Le 30 novembre, il harangue 10 000 parisiens réunis par Étienne Marcel au pré aux clercs. Le 3 décembre, Étienne Marcel s’invite avec un fort parti bourgeois au conseil qui doit décider de la réhabilitation de Charles de Navarre, sous prétexte d’annoncer que les états réunis aux cordeliers ont consenti à lever l’impôt demandé par le dauphin et qu’il ne reste que l’accord de la noblesse à obtenir (qui se réunit séparément des autres états). Au vu de cette démonstration de force, le dauphin ne peut faire autrement que de se réconcilier avec Charles de Navarre et lui restituer ses possessions normandes[80]. Ce dernier élève des prétentions sur plusieurs provinces (dont la Champagne dont il a été dépossédé par Jean le Bon). Le dauphin ne peut encore faire que d’acquiescer et de réhabiliter Charles le Mauvais[81], mais pis encore, les états doivent trancher la question dynastique, le 14 Janvier 1358. La couronne des Valois est menacée. Charles Mauvais exploite le mois d’attente pour faire campagne.
Craignant que le Navarrais puisse s'emparer du pouvoir, Jean le Bon doit reprendre les choses en main et négocie sa libération: il accepte le premier traité de Londres qui prévoit que l’Angleterre récupère l’ensemble de ses anciennes possessions d’Aquitaine et une rançon de 4 millions d’écus sans renonciation à la couronne de France[82]. De même, Jean II, depuis sa prison de Londres, interdit l'application de la grande ordonnance, ce qui provoque un conflit ouvert entre Étienne Marcel et le dauphin.
Meurtre des maréchaux. En arrière-plan, Étienne Marcel tend un chaperon rouge et bleu au dauphin.
Meurtre des maréchaux. En arrière-plan, Étienne Marcel tend un chaperon rouge et bleu au dauphin.
Le 13 janvier 1358, les états généraux sont de nouveau convoqués par le conseil de tutelle (qui après épuration est contrôlé par des proches d'Étienne Marcel)[83]. Devant l’opposition du dauphin, Étienne Marcel décide d’imposer sa réforme par la force et rallie les commerçants parisiens à sa cause. Il crée une milice sous prétexte de défense contre les éventuelles attaques des Anglais, alors repliés à Bordeaux et renforce les fortifications de Paris.
Le 22 février 1358, Étienne Marcel, escorté par de nombreux hommes en armes et à la tête d’une foule rageuse, envahit le palais royal de la Cité où réside le dauphin. Voulant s’interposer, le maréchal de Champagne Jean de Conflans et le maréchal de Normandie Robert de Clermont sont tués devant le dauphin, qui croit sa dernière heure arrivée. Marcel l’oblige à coiffer le chaperon rouge et bleu et à renouveler l’ordonnance de 1357[84]. Puis, c’est la chasse à l’homme au cours de laquelle l’avocat général, Renaud d’Acy, qui s’était réfugié dans une pâtisserie, est égorgé férocement.
Il force ensuite le dauphin à ratifier le meurtre de ses conseillers. Le dauphin ne peut qu’accepter un nouveau changement institutionnel : son conseil est épuré : 4 Bourgeois y rentrent, le gouvernement et les finances sont aux mains des états[85], Charles le Mauvais reçoit un commandement militaire et de quoi financer une armée de 1 000 hommes, le dauphin lui obtient de devenir régent du royaume ce qui permet de ne plus tenir compte des décisions du roi tant qu’il est en captivité (et en particulier des traités de paix inacceptables)[86].
Préférant s’éloigner de la fureur parisienne, le Dauphin Charles quitte la capitale pour Compiègne: La noblesse qui s'y réuni séparément des deux autres états, pour ratifier la nouvelle ordonnance, à l’abri de toute agitation. Champenois et Bourguignons sont choqués par l'assassinat des maréchaux et rallient le camp du Dauphin. Ce dernier fait solennellement condamner Étienne Marcel par les députés. Fort de ce soutien, il s’empare des forteresses de Montereau et de Meaux. L’accès est de Paris est bloqué[87]. Au sud et à l’ouest, les compagnies écument le pays et il est crucial pour Étienne Marcel de préserver les communications avec les villes des Flandres: il faut dégager la route du Nord.
Royaume de France entre 1356 et 1363: Jacqueries et Compagnies ██ Possessions de Charles de Navarre ██ Territoires contrôlés par Édouard III avant le traité de Brétigny Chevauchée d'Édouard III en 1359-60 ██ Territoires cédés par la France à l'Angleterre par le traité de Brétigny (suit le tracé du premier traité de Londres)
Royaume de France entre 1356 et 1363: Jacqueries et Compagnies ██ Possessions de Charles de Navarre ██ Territoires contrôlés par Édouard III avant le traité de Brétigny
Chevauchée d'Édouard III en 1359-60
██ Territoires cédés par la France à l'Angleterre par le traité de Brétigny (suit le tracé du premier traité de Londres)
À la fin du mois de mai 1358, se déclenche la Grande Jacquerie : des paysans (principalement de petits propriétaires fonciers), excédés par le renforcement de la rente seigneuriale alors que le prix du blé baisse, se révoltent contre la noblesse. Cette dernière, déjà discréditée par les défaites de Crécy et de Poitiers, n’est plus en mesure de protéger les petites gens. Ce mouvement décrit par les chroniqueurs de l'époque comme extrêmement violent (cette violence a probablement été exagérée) est principalement dirigé contre les nobles qui, s’ils ne sont pas massacrés, voient leurs châteaux pillés et brûlés. 5 000 hommes se regroupent rapidement autour d’un chef charismatique : Guillaume Carl, il reçoit très rapidement des renforts de la part d’Étienne Marcel, dont l’objectif est de libérer Paris de l’encerclement que le dauphin est en train de réaliser en privilégiant l’accès nord qui permet de communiquer avec les puissantes villes des Flandres[88]. Le 9 juin, les hommes du Prévost de Paris et une partie des jacques conduisent un assaut sur le marché de Meaux où est le régent et sa famille pour s’assurer de sa personne[89]. C’est un échec : alors que les jacques se ruent à l’assaut de la forteresse sur le pont qui permet d’y accéder les portes s’ouvrent et ils sont balayés par une charge de cavalerie[90]. Mais le gros des forces de Guillaume Carl, vont en découdre à Mello le 10 juin. Pressé par la noblesse, dont il est le leader et particulièrement par les Picquigny auxquels il doit la liberté et dont le frère vient d’être massacré par les jacques, Charles le Mauvais prend la tête de la répression. Il engage des mercenaires anglais, rallie la noblesse, s’empare de Guillaume Carl venu négocier et charge les jacques décapités[91]. C’est un massacre : la jacquerie se termine dans un bain de sang dont Charles le Mauvais porte la responsabilité et où le dauphin a su garder les mains propres. Le Navarrais, fort de son succès contre les Jacques, rallie Étienne Marcel espèrant que la noblesse qu'il vient de mener à la victoire contre les jacques le suive, mais on l'a vu à Compiègne, la noblesse n'a pas pardonné l'assassinat des maréchaux et se place sous la bannière du dauphin. Les troupes du Dauphin sont rejointes par les compagnies qui rêvent de participer au pillage de Paris. Charles de Navarre attend des renforts anglais pour compenser ses pertes, les Parisiens loyalistes y voient une trahison et se rebellent à leur tour. Le 31 juillet 1358, Étienne Marcel est exécuté alors qu'il cherchait à faire rentrer des mercenaires anglais dans Paris et le dauphin reprend les rênes du pouvoir.
Icône de détail Articles détaillés : Grande Jacquerie, Étienne Marcel et Charles le Mauvais.
Cependant, le roi Jean II cherche à présent à revenir au plus vite pour reprendre le contrôle de la situation, les Anglais peuvent négocier au plus cher sa libération (l’endenture) : ils exigent toutes les terres leur ayant appartenu, soit plus de la moitié du royaume. Accéder à ces revendications affaiblirait encore le pouvoir royal et pourrait relancer la guerre civile, offrant à Édouard III la France (il revendique la couronne étant petit-fils de Philippe le Bel).
Icône de détail Article détaillé : Traités de Londres (1358 et 1359).
Le traité de Brétigny [modifier]
Le dauphin Charles fait appel aux États Généraux qui refusent de signer ce traité humiliant et catastrophique[92]. Ce faisant, il se dédouane ainsi que son père et ressoude le pays contre les Anglais. Édouard III décide alors de passer à nouveau à l’action.
Débarquant à Calais le 28 octobre 1359, il chevauche en direction de Reims, la ville du sacre (un sacre y aurait des conséquences catastrophiques pour les Valois puisqu’il tient la vie de Jean le Bon entre ses mains). Mais le dauphin Charles a pris les devants et applique la stratégie de la terre déserte. Il a ordonné à tous les habitants des campagnes de se réfugier, avec toutes leurs provisions et matériels, dans les villes fortifiées. Édouard, traversant un pays vide, doit se contenter de ses réserves. Arrivé devant Reims, il trouve les portes fermées. Il demande la reddition de la cité. Les échevins refusent, par fidélité au Dauphin Charles. L’armée anglaise qui n’était pas équipée pour un siège est obligée de plier bagages au bout d'un mois[93][94].
Édouard est furieux, il cherche à provoquer une grande bataille avec les Français. Ceux-ci sont invisibles, mais les retardataires et les éclaireurs anglais tombent fréquemment dans des embuscades où ils sont massacrés. Finalement, Édouard arrive devant Paris, où le dauphin s’est enfermé avec la population d’Île-de-France. Malgré les provocations, le dauphin interdit à ses chevaliers de livrer bataille. Il ne veut pas renouveler la défaite de Poitiers.
Au bout de 12 jours, Édouard III doit quitter Paris pour rembarquer le plus vite possible car il n’a plus de vivres, la plupart de ses chevaux étant morts faute de fourrage et il a perdu un nombre non négligeable d’hommes. De plus, un raid de marins normands à Winchelsea[95] en mars 1360 a semé la panique en Angleterre[96]. Dans la Beauce, le reste de son armée est pris dans un violent orage qui la disloque. Cet évènement est perçu comme miraculeux[94] et l’expression d’une volonté divine et renforce la légitimité des Valois très affaiblie par leurs échecs militaires de Crécy et Poitiers. La chevauchée de 1359 se solde par un échec retentissant et ses conséquences psychologiques sur Édouard III sont cruciales : il prend conscience que la différence démographique et les aspirations nationales naissantes ne lui permettent pas de contrôler un territoire aussi vaste : il ne pourra jamais être roi de France[97]. Cependant, la capture de Jean le Bon lui donne du pouvoir de négociation.
1365: La France après les traités de Brétigny et de Guérande. ██ Territoires contrôlés par Édouard III ██ Territoires cédés par la France à l'Angleterre par le traité de Brétigny ██ Territoire du duché de Bretagne, allié aux Anglais
1365: La France après les traités de Brétigny et de Guérande. ██ Territoires contrôlés par Édouard III ██ Territoires cédés par la France à l'Angleterre par le traité de Brétigny ██ Territoire du duché de Bretagne, allié aux Anglais
Le traité de Brétigny-Calais conclut finalement le conflit :
* Rançon de trois millions de livres pour la libération de Jean II le Bon (équivalent à la totalité des recettes du roi pendant deux ans)
* Le roi d’Angleterre obtient la souveraineté sur la Guyenne et la Gascogne, Calais et le Ponthieu, le comté de Guines, le Poitou, le Périgord, le Limousin, l’Angoumois, la Saintonge, l’Agenais, le Quercy, le Rouergue, la Bigorre et le comté de Gaure[98].
Le traité vise à désamorcer tous les griefs qui ont conduit au déclenchement du conflit. Édouard III renonce donc aux duchés de Normandie et de Touraine, aux comtés du Maine et d’Anjou et à la suzeraineté sur la Bretagne et les Flandres. Il renonce surtout à revendiquer la couronne de France.[99]
La reprise de la guerre de succession de Bretagne n’est pas très heureuse pour les Français : Charles de Blois et Bertrand Duguesclin sont défaits à Auray par le futur Jean IV de Bretagne et John Chandos[100]. Cette bataille débouche sur le traité de Guérande qui reconnaît Jean IV comme duc de Bretagne, les Anglais gardent le contrôle de Brest et de sa région[101].
Au total, les Anglais sont maîtres d’un bon tiers du royaume de France, et le duché de Bretagne est contrôlé par un de leurs alliés (Jean IV épouse une sœur puis une belle-fille du Prince Noir). Mais Charles V est un bon tacticien : la paix obtenue permet de redonner au futur roi (son père Jean le Bon meurt le 8 avril 1364) les capacités de reconquérir les territoires cédés.
La reconquête de Charles V le Sage : de 1364 à 1380 [modifier]
Le Franc à cheval représente le roi Jean le Bon qui a gardé une image de roi à l'esprit chevaleresque dans la population. Le franc vaut une livre tournois, sa création restaure l'autorité royale en mettant fin aux mutations monétaires.
Le Franc à cheval représente le roi Jean le Bon qui a gardé une image de roi à l'esprit chevaleresque dans la population. Le franc vaut une livre tournois, sa création restaure l'autorité royale en mettant fin aux mutations monétaires.
Bertrand du Guesclin à la Bataille de Cocherel
Bertrand du Guesclin à la Bataille de Cocherel
Sources : Wikipédia.
Dernière modification par daminoux-91 (06-10-2008 20:22:08)
Yeah !

ORELSAN !!!!!
Hors ligne
#2 06-10-2008 20:21:51
- Kro.29
- Invité

- Serveur 1
- Lieu: Brest, La ZUP B2
- Date d'inscription: 30-09-2008
Re: La guerre de cent ans.
T'as dut trop te faire chier à écrire tout ça  Merci de faire partager TA culture
Merci de faire partager TA culture 
▀▀█▀▀ █ █▀▀▀█ █▀▀▀▀ █▀▀▀█ █▀▀▀█ █ █ █▀▀▀▀ █ █ ▄
█ █ █▄▄▄█ █▄▄▄▄ ▄▄ █▄▄▄█ █ █ █ █ █ █▄▄▄█
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █
█ █ █ █ █▄▄▄▄ █▄▄▄█ █▄▄▄█ █▄▄▄█ █▄▄▄▄ █ █
Hors ligne
#3 06-10-2008 20:21:51
- Elisha-Cuthbert
- Invité

- Serveur 1
- Lieu: Liberté pour les ultras
- Date d'inscription: 08-07-2008
- Site web
Re: La guerre de cent ans.
Bah oui, on vaaaaa touuuut liiiiiiire !!!!!!
Auteuil Grinta AFO
AFO ==> 1ère Division <== // Premier League ==> WBA <==
"Quand je marque un but je ne fais pas la fête car c'est mon métier, t'as déjà vu un facteur sauter de joie quand il a livré le courrier? "
Hors ligne
#4 06-10-2008 20:21:57
- Neo-rijsel
- Fan de Foot-Land

- Serveur 1 et 2
- Lieu: Dans tes pires cauchemars
- Date d'inscription: 08-07-2008
Re: La guerre de cent ans.
La guerre de cent ans qui comme tout le monde le sait à duré .. ? (attention y a un piège ^^)
Hors ligne
#5 06-10-2008 20:22:22
- guitou9
- Fan de Foot-Land

- Serveur 1 et 2
- Lieu: Belgium Belgium Belgium
- Date d'inscription: 08-07-2008
Re: La guerre de cent ans.
Neo-rijsel a écrit:
La guerre de cent ans qui comme tout le monde le sait à duré .. ? (attention y a un piège ^^)
115 ans 
"Anderlecht est à la recherche de sa grandeur passée, car on parle quand même là d’un club qui a gagné plus de coupes d’Europe que le foot français dans son ensemble." (source: sofoot.com, le 27/07/2011)
Hors ligne
#7 06-10-2008 20:22:55
- Elisha-Cuthbert
- Invité

- Serveur 1
- Lieu: Liberté pour les ultras
- Date d'inscription: 08-07-2008
- Site web
Re: La guerre de cent ans.
Neo-rijsel a écrit:
La guerre de cent ans qui comme tout le monde le sait à duré .. ? (attention y a un piège ^^)
En meme temps son pavé commence par ca ^^
Auteuil Grinta AFO
AFO ==> 1ère Division <== // Premier League ==> WBA <==
"Quand je marque un but je ne fais pas la fête car c'est mon métier, t'as déjà vu un facteur sauter de joie quand il a livré le courrier? "
Hors ligne
#8 06-10-2008 20:23:05
- Lucenzo
- Invité
Re: La guerre de cent ans.
116 ans 
#9 06-10-2008 20:23:36
- Dark_Thumb
- Invité

- Serveur 1
- Lieu: Toulouse
- Date d'inscription: 08-07-2008
- Site web
Re: La guerre de cent ans.
Quel est l'intérêt de ce sujet ?
[ FL-Féd - Edge ] [ Tolosa F.C. ] ↘
⇅ 1 FL Undisputed - 2 WHC - 2 FL - 4 Tag Team - 2 Hardcore
[ Palmarès actuel : 14 - 00 - 00 ] ↗
Hors ligne
#10 06-10-2008 20:23:36
- zerto-
- Invité
- Serveur 1
- Lieu: ! 12 Lensois !
- Date d'inscription: 10-07-2008
Re: La guerre de cent ans.
Pas de l'histoire 
De plus, je suis pas assez fatigué pour ça 

Runje - Ramos - Yahia - Chelle - Demont - Hermach - Kovacevic - Akale - Roudet - Boukari - Maoulida.
Hors ligne
#11 06-10-2008 20:23:40
- Maurizio_29
- Bavard(e)

- Serveur 1
- Lieu: BREST
- Date d'inscription: 08-07-2008
- Site web
Re: La guerre de cent ans.
topic un peu inutile non ?
Hors ligne
#12 06-10-2008 20:26:07
- ze_egleb
- Invité
- Serveur 1
- Date d'inscription: 08-07-2008
Re: La guerre de cent ans.
Et pas qu'un peu, je me demande même si je devrais pas bannir pour ce genre de topics allakon.
Hors ligne
